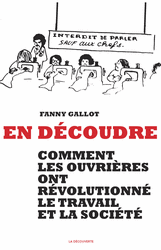Femmes et ouvrières en lutte
Publié le 22 Mai 2015
Les ouvrières demeurent délaissées par l'histoire des femmes et surtout du mouvement ouvrier. Elles subissent pourtant une double oppression : de genre et de classe. L’historienne Fanny Gallot se penche sur les ouvrières dans son livre intitulé En découdre. De l’insubordination ouvrière des années 1968 aux plans de licenciement des années 2000, cette étude évoque les mutations du capitalisme et des luttes sociales. Les usines de Chantelle et de Moulinex deviennent un terrain d’observation de cette étude.
Des jeunes ouvrières non qualifiées sont embauchées durant les années 1970. C’est toute une génération qui traverse l’usine. Une véritable communauté se développent, avec des liens forts qui unissent les ouvrières. A partir des années 1980, des salariées sont recrutées en intérim ou en contrat précaire. Les ouvrières les plus jeunes veulent travailler plus rapidement de peur que leur contrat ne soit pas reconduit. Un clivage s’observe alors entre les générations.
Les ouvrières subissent une « vie de fous » et doivent toujours courir. Le temps de travail domestique s’ajoute au temps de travail salarié et de transports. Les ouvrières doivent s’imposer une gestion et une programmation du temps. Les moments de détente deviennent très rares. Dans les usines, l’horloge et le chronomètre imposent leurs cadences, comme dans le film Coup pour coup.
Dans les années 1968, des mouvements de contestation s’organisent autour du « temps de vivre ». Des formes de réappropriation du temps se développent. L’ambiance de travail permet de s’adapter et d’oublier les contraintes de temps, de penser à autre chose en discutant ou en riant. Des phénomènes d’« autoréduction » des cadences permettent aux ouvrières de décider ensemble de baisser leur rythme.
Durant les années 1970, la CGT valorise le rôle de la mère et de la famille tout en défendant les revendications des travailleuses. La CFDT, malgré ses origines chrétiennes, n’hésite pas à attaquer les valeurs traditionnelles et même la consensuelle fête des mères. « Valorisant le rôle de la mère, elle contribue à assigner aux femmes seules le rôle d’entretien des enfants au détriment de toute autre activité professionnelle, sociale ou politique », dénonce un tract. Le patronat, incarné par le CNPF, estime que la femme est un handicap. L’homme doit travailler pour nourrir la famille. Le travail des femmes est considéré comme un simple supplément.
Les féministes rejettent la notion de maternité, selon laquelle seules les femmes doivent s’occuper des enfants. La notion de parenté est alors utilisé. L’enfant est celui du père autant que de la mère. Au contraire, la CGT et le patronat, estiment que la maternité incombe uniquement aux femme. La CGT revendique la construction de crèches ou la permission pour garder un enfant malade. « Comment concilier les soins à donner à donner à un enfant malade et l’obligation d’être au travail ? », ose titrer le CNPF pour une brochure évidemment réactionnaire.
Une véritable ségrégation sexuelle s’observe dans les usines. Les femmes sont cantonnées au travail à la chaîne, sans espoir d’évolution, tandis que les postes à responsabilités sont tous occupés par des hommes. Les ouvrières sont infantilisées selon des stéréotypes sexistes. Les « bavardages et déplacements abusifs » sont particulièrement contrôlés. Les chefs d’atelier et contremaîtres sont tous des hommes. Même si les postes d’encadrement intermédiaires se féminisent progressivement.
Au début des années 1968, les ouvrières dénoncent les conditions de travail et de sécurité. La saleté, la toxicité, l’éclairage, la posture, la chaleur, la poussière deviennent insupportables. Les syndicats comme la CGT se contentent de demander des primes. Moqué comme un « syndicat beefsteak », la CGT ne jure que les augmentations de salaires sans dénoncer le travail à la chaîne. A partir de Mai 68, l’ordre usinier et le taylorisme comme instrument de contrôle social sont attaqués. Les cadences et le comportement de la maîtrise sont dénoncés. La CFDT tente de s’adapter aux nouvelles revendications sur les conditions de travail.
Les crises de nerfs, considérées comme manifestations de l’hystérie féminine, demeurent liées aux conditions de travail. « La faible sollicitation physique se double d’une sollicitation mentale apparemment nulle, puisque les ouvrières estiment qu’elles agissent comme des robots », précise Fanny Gallot. Les gestes répétitifs engendrent un sentiment débilitant. Une fatigue nerveuse se développe. Les ouvrières dénoncent et politisent ce phénomène.

Une fierté ouvrière se manifeste à l’égard du produit, de l’entreprise et de l’attachement au travail. Les ouvrières consomment les produits qu’elles fabriquent et les considèrent comme les meilleurs. Elles bénéficient de réductions pour acheter les produits de leur entreprise. Ensuite, les ouvrières tentent de reconquérir leur autonomie par la consommation. Apparaître élégante et bien habillée permet de sortir de la stigmatisation sociale et d’affirmer sa féminité. Même si les maoïstes leur reprochent de ne surtout pas vouloir ressembler à des ouvrières.
L’usine doit également apparaître comme une grande famille. Le paternalisme doit maintenir les ouvrières dans des positions subalternes tout en les valorisant en tant que consommatrices. L’appellation « les filles » traduit ce mépris paternaliste. Les fêtes dans les usines permettent de se réapproprier l’usine par des moments de plaisir. Mais cette fausse convivialité peut aussi viser à rapprocher les ouvrières de la direction. Mais si les clivages de classe perdurent malgré tout.
Les ouvrières luttent pour leur dignité. Les hommes qui les encadrent sont moqués comme des « petits coqs ». Elles dénoncent progressivement le harcèlement moral et sexuel, mais aussi les humiliations des petits chefs au moment des règles. « Si elles se réfèrent à la dignité au sens de Robert Castel, mettant en cause l’aliénation dans le travail, elles mettent également en avant le manque de respect qu’elles ressentent en tant que femmes », souligne Fanny Gallot.
Le chef use de la séduction et de plaisanteries pour séduire les ouvrières. Mais lorsque cette domination de genre échoue, il revient à la bonne vieille domination de classe en imposant son autorité hiérarchique.
Les hommes et les maris n’acceptent pas que leurs femmes s’organisent de manière autonome. Les maris et les hommes de la CGT surveillent les ouvrières lorsqu’elles font grève. Ils vont même jusqu’à inspecter les usines occupées par des femmes pour bien contrôler la lutte. Les ouvrières, même syndiquées à la CGT, subissent un étroit contrôle des militants hommes et des bureaucrates. Les ouvrières parviennent néanmoins à organiser la lutte elles-mêmes et à refuser la présence des maris.

Les militantes féministes s’intéressent évidemment aux luttes des ouvrières. Elles peuvent ainsi relier leurs revendications spécifiques avec celles de la classe ouvrière valorisées par l’extrême gauche des années 1970. « Les militantes féministes vont à la rencontre des ouvrières, afin de restituer leur parole dans leur presse, et les encourager à s’exprimer dans l’espace public », précise Fanny Gallot. Une solidarité entre femmes doit alors se construire. Mais la prise de parole des ouvrières semble difficile. Les responsables syndicaux les empêchent de s’exprimer et les ouvrières elles-mêmes ne se sentent pas légitimes.
Les féministes veulent mettre en avant la politisation des ouvrières qui s’opère dans la lutte. Les films et journaux féministes insistent sur la vie privée des ouvrières pendant les grèves. L’autonomie des femmes par rapport au couple et à la famille est mise en avant. La lutte permet un changement dans la vie quotidienne, mais aussi dans « leur rapport à leur corps et à leur intimité ». L’avortement, la contraception et le plaisir sexuel sont des sujets abordés. La parole des ouvrières est fidèlement retranscrite même si elles n’adoptent pas toujours le point de vue des féministes.
Les syndicats, notamment la CGT, s’opposent aux revendications des femmes. Ils dénoncent les luttes spécifiques, mais aussi les féministes assimilées aux « gauchistes » et à des « petites bourgeoises ». Mais des ouvrières commencent à se réclamer féministe et veulent créer des commissions féminines dans leurs organisations syndicales. Les luttes des ouvrières permettent de sortir de l’assignation de genre. La nécessité de s’opposer au patron et de prendre la parole permet une métamorphose. « Finalement, c’est le fait d’habiter son rôle de classe en affrontant le patron qui bouleverse son rôle de genre », résume Fanny Gallot.

Les femmes en grève insistent sur la dimension festive de la lutte et de l’occupation d’usine. « Entre nous, ça marche très fort. On fait des chansons, on rigole », témoigne une gréviste. Un collectif de femmes s’organisent de manière autonome par rapport aux responsables syndicaux qui sont des hommes. Les bureaucrates et politiciens imposent un regard paternaliste sur les femmes en grève. Ce qui peut aussi alimenter leur popularité, comme avec l’appellation les "filles" de Chantelle. « Si les ouvrières peuvent se sentir dévalorisées et réduites à leur genre, elles sont bien conscientes que cela favorise le soutien de la population locale », observe Fanny Gallot.
Quand les grèves éclatent dans des entreprises mixtes, comme à Moulinex, les femmes participent activement à la lutte. Elles impulsent même le mouvement et incitent les autres ouvrières à prendre la parole. En revanche, les femmes ne remettent pas en cause la direction du mouvement, presque exclusivement masculine.
Les femmes adoptent des pratiques de lutte offensives comme les séquestrations de patron. Les humiliations subies par les ouvrières se retournent contre l’exploiteur. Les femmes expriment également une forte créativité. Des chansons détournées reviennent sur des exemples du quotidien et insistent sur les conditions de travail, avec les « cadences » et le « chrono ». Dans les entreprises mixtes , c’est le « pognon » ou le « capital » qui sont davantage mis en avant. Ces chansons détournées contribuent à forger une expression spécifique de grévistes.
Les femmes sont également sollicitées pour jouer et réaliser des films, comme avec les groupes Medvedkine. Le film Coup pour coup de Marin Karmitz met en scène des ouvrières en lutte qui jouent leur propre rôle. Ce film exprime « la volonté mainte fois manifeste de femmes, particulièrement celles qu’on rencontre rarement, les ouvrières d’usine, de se faire entendre, de transformer leur vie quotidienne ».
Les ouvrières subissent à la fois les normes de genre et les normes de classe. Cette population semble pourtant oubliée. Les féminismes bourgeois et postmodernes tentent de gommer l’identité de classe. Inversement, le discours sur la lutte des classes tend à rendre invisible l’identité de genre. L’ouvrier en bleu de travail, casquette visée sur la tête et clope au bec monopolise l’imaginaire militant. Le prolétariat, notamment le plus précaire, comprend pourtant une majorité de femmes.
Des ouvrières qui luttent, qui redressent la tête, se révoltent progressivement contre toutes les formes d’oppression. Quand des ouvrières se mettent en grève, ce sont toutes les formes d’autorité qui vacillent, dans le travail comme dans la vie quotidienne. Ces femmes qui luttent veulent transformer le monde pour changer leur vie.
Source :
Fanny Gallot, En découdre. Comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société, La Découverte, 2015
Livre issu de la thèse de Fanny Gallot, Les ouvrières, des années 1968 au très contemporain : pratiques et représentations
Extrait du livre publié sur le site de la revue Contretemps le 29 mai 2015
/image%2F0556198%2F20160103%2Fob_2682c5_rhum-express-pics.jpg)